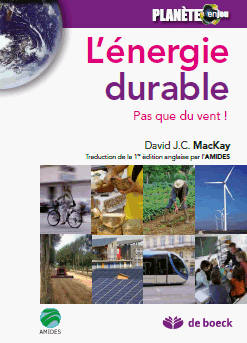23 – Des combustibles fossiles durables ?
Les combustibles fossiles resteront une part importante de notre mix énergétique durant les décennies à venir : c’est une réalité incontournable.
Porte-parole du gouvernement britannique, avril 2008
Notre condition actuelle de croissance heureuse ne durera qu’un temps limité.
William Stanley Jevons, 1865
Dans les trois chapitres précédents, nous avons exploré les principales technologies et les changements de style de vie afin de réduire notre consommation d’énergie. Nous sommes arrivés à la conclusion que l’on pouvait diviser par deux la dépense énergétique liée aux transports (tout en la dé-fossilisant) en nous convertissant aux véhicules électriques. Nous avons trouvé que l’on pouvait réduire encore plus la consommation énergétique de chauffage (et la dé-fossiliser) en améliorant l’isolation de tous les bâtiments et en utilisant des pompes à chaleur électriques plutôt que des combustibles fossiles. Donc oui, nous pouvons réduire notre consommation. Cependant, faire correspondre cette consommation, même réduite, avec les ressources renouvelables propres à la Grande-Bretagne semble un défi colossal (figure 18.7, page 130). Il est temps de débattre des options non renouvelables pour la production d’énergie.
Prenez les réserves connues de combustibles fossiles, qui sont, pour une écrasante part, constituées de charbon : 1 600 Gt de charbon. Partagez-les de manière égale entre 6 milliards de personnes, et brûlez-les « de manière durable ». Attendez, ça veut dire quoi, utiliser « de manière durable » une ressource qui n’existe qu’en quantité finie ? Voici la définition arbitraire que je vais utiliser : le rythme de combustion est dit « durable » si les ressources peuvent durer 1 000 ans.1 Une tonne de charbon fournit 8 000 kWh d’énergie chimique,2 donc 1 600 Gt de charbon partagées entre 6 milliards de personnes sur 1 000 ans, cela fait une puissance de 6 kWh par jour et par personne. Une centrale à charbon standard convertirait cette puissance en électricité avec une efficacité d’environ 37 % — cela se traduit par environ 2.2 kWh(e) par jour et par personne. Cependant, si l’on se soucie du climat, alors on n’utilisera vraisemblablement pas une centrale à charbon standard. On fera plutôt dans le « charbon propre », également connu sous l’expression « charbon avec capture et séquestration du carbone » 3 — une technologie encore à peine mise en œuvre pour l’instant, et qui aspire l’essentiel du dioxyde de carbone des gaz de cheminée pour l’expédier dans un trou dans le sol. Ce nettoyage des émissions d’une centrale a un coût énergétique significatif — cela réduirait la quantité d’électricité fournie d’environ 25 %. Une exploitation « durable » des réserves de charbon connues ne fournirait donc qu’environ 1,6 kWh(e) par jour et par personne.
On peut comparer ce rythme « durable » de combustion du charbon — 1,6 Gt par an — au rythme actuel de consommation de charbon : 6,3 Gt par an — et il augmente toujours.
Quid du seul Royaume-Uni ? Les réserves restantes de charbon en Grande-Bretagne sont estimées à 7 Gt.4 Bien. Partageons ces 7 Gt entre 60 millions de personnes : on trouve 100 tonnes par personne. Et si l’on veut une solution pour 1 000 ans, cela correspond à 2,5 kWh par jour et par personne. Et dans une centrale qui capture et séquestre le carbone, cette approche durable avec du charbon britannique offrirait 0,7 kWh(e) par jour et par personne.

Notre conclusion est claire :
Le charbon propre ne peut être qu’un pis-aller temporaire.
Si l’on décide de développer la technologie du « charbon propre » pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il nous faut être attentif, pendant que l’on s’auto-congratule, à faire nos comptes correctement et honnêtement. Le processus de combustion du charbon libère des gaz à effet de serre au niveau de la centrale, mais aussi depuis la mine. L’extraction de charbon dans les mines a tendance à libérer du méthane, du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone,5 à la fois directement des veines de charbon au moment où on les expose à l’air, et, par la suite, des schistes et des limons que l’on rejette sous forme de stériles. Pour une centrale à charbon ordinaire, ces émissions minières font grimper l’empreinte de gaz à effet de serre d’environ 2 % ; ces émissions auront donc un impact significatif sur le bilan d’une centrale « propre ». Un problème comptable similaire se pose avec le gaz naturel : si, disons, 5 % du gaz naturel fuite pendant son transport du puits à la centrale, cette pollution accidentelle au méthane est équivalente (en effet de serre) à un supplément de 40 % du dioxyde de carbone émis par la centrale.6
Nouvelles technologies charbonnières
La société directcarbon.com, basée à Stanford, développe en ce moment la pile à combustible à charbon direct, qui convertit le combustible et l’air directement en électricité et en CO2, sans avoir besoin d’eau ou de turbine à vapeur. Ils prétendent que cette technique de génération d’électricité à partir du charbon a un rendement deux fois meilleur que celui d’une centrale à charbon standard.
Et si on ne change rien, ça va durer combien de temps ?
L’économiste Jevons a fait un calcul simple en 1865. Les gens débattaient du temps que durerait le charbon britannique. Ils avaient tendance à répondre à cette question en divisant la quantité estimé de charbon restant par le rythme de sa consommation, et obtenaient des réponses du genre « 1 000 ans ». Mais, remarqua Jevons, la consommation n’est pas constante. Elle a doublé tous les 20 ans, et le « progrès » fera qu’elle continuera sur sa lancée. Donc les « réserves divisées par le rythme de consommation » donne une réponse fausse.
Au lieu de cela, Jevons a extrapolé la croissance exponentielle de la consommation, calculant le moment à partir duquel la quantité totale consommée dépasserait les réserves estimées. Le délai calculé était beaucoup plus court. Jevons ne s’imaginait pas que la consommation continuerait toujours à croître au même rythme ; simplement, il mettait en évidence le fait que cette croissance ne pourrait pas durer éternellement. Son calcul faisait, à l’intention de son lectorat britannique, une estimation des inévitables limites à leur croissance, et du court laps de temps restant avant que ces limites ne deviennent une évidence. Jevons fit la prédiction osée que la fin du « progrès » britannique surviendrait dans les 100 années suivant 1865. Et Jevons ne s’est pas trompé. La production de charbon en Grande-Bretagne a atteint un pic en 1910, et en 1965, la Grande-Bretagne n’était plus une superpuissance mondiale.
Refaisons son calcul pour le monde entier. En 2006, le rythme de consommation de charbon était de 6,3 Gt par an. En comparant ce chiffre aux réserves connues de 1 600 Gt de charbon, on entend souvent dire « il reste 250 ans de charbon ». Mais si l’on part du principe que le « business as usual » implique une consommation croissante et non constante, on obtient une réponse différente. Si la croissance de la consommation de charbon devait continuer à un rythme de 2 % par an (ce qui correspond à peu près aux données de la période 1930–2000), alors tout le charbon aura disparu en 2096. Si le rythme de croissance se maintient à 3,4 % par an (celui que le monde a connu durant la dernière décennie), la fin du business as usual est pour avant 2072. Pas 250 ans : 60 ans !
Si Jevons vivait encore aujourd’hui, je suis sûr qu’il prédirait formellement qu’à moins de choisir, par nous-mêmes, une autre voie que le business as usual, nous allons connaître, autour de 2050 ou 2060, la fin de notre condition de croissance heureuse.

Notes et bibliographie
↑ 1 1 000 ans — ma définition arbitraire de « durable ». À titre de précédent à ce type de choix, Hansen et al. (2007) assimilent « plus de 500 ans » à « pour toujours ».
↑ 2 1 tonne équivalent charbon = 29,3 GJ = 8 000 kWh d’énergie chimique. Ce chiffre ne prend pas en compte les coûts énergétiques de l’exploitation minière, du transport et de la séquestration de carbone.
↑ 3 Capture et séquestration du carbone (CSC). Il y a plusieurs technologies de CSC. Aspirer le CO2 à partir des gaz de cheminée est l’une d’entre elles ; d’autres gazéifient le charbon et séparent le CO2 avant combustion. Voir Metz et al. (2005). Le premier prototype de centrale à charbon avec CSC a été mis en service le 9 septembre 2008 par la société suédoise Vattenfall [5kpjk8].
↑ 4 Charbon en Grande-Bretagne. En décembre 2005, les réserves et ressources des mines existantes étaient estimées à 350 millions de tonnes. En novembre 2005, les réserves potentielles à ciel ouvert étaient estimées à 620 millions de tonnes, et le potentiel de gazéification du charbon en sous-sol à au moins 7 milliards de tonnes [yebuk8]
↑ 5
L’extraction de charbon dans les mines a tendance à libérer des gaz à effet de serre.
Pour plus d’informations au sujet de la libération de méthane par l’exploitation
minière du charbon, voir www.epa.gov/cmop/, Jackson et Kershaw (1996),
Thakur et al. (1996). Les émissions mondiales de méthane dues à l’extraction du charbon sont d’environ 400 millions
de tonnes équivalent CO2 par an. Cela correspond à environ 2 % des émissions de gaz à effet de serre liées à la
combustion du charbon.
Le contenu moyen en méthane des veines de charbon britanniques est de 4,7 m3 par tonne de charbon (Jackson et
Kershaw, 1996) ; ce méthane, s’il est relâché dans l’atmosphère, a un potentiel de réchauffement climatique d’environ
5 % de celui du CO2 obtenu en brûlant le charbon.
↑ 6 Si 5 % du gaz naturel fuite, c’est équivalent à un supplément de 40 % en dioxyde de carbone. En termes d’effet de serre planétaire, la pollution accidentelle au méthane est près de huit fois plus importante que la pollution au CO2 qui surviendrait si on brûlait ce méthane ; 8 fois, et non les « 23 fois » standard, parce que les « 23 fois » sont le ratio de réchauffement entre masses égales de méthane et de CO2. Chaque tonne de CH4 se transforme en 2,75 tonnes de CO2 si on la brûle ; si elle fuit, elle est équivalente à 23 tonnes de CO2. Et 23/2,75, cela fait 8,4.
Pour en savoir plus : World Energy Council [yhxf8b]
Pour en savoir plus sur la gazéification du charbon en sous-sol : [e2m9n]